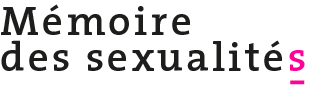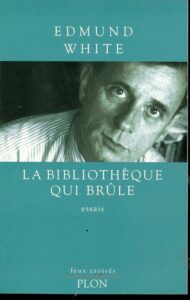La bibliothèque qui brûle
paru en 1997
de l’écrivain américain Edmund White
(1940-2025)
Il est né à Cincinnati dans l’Ohio, dans une famille très homophobe.
En 1971 il écrit dans The Gay Militants de Donn Teal il raconte qu’il a découvert son homosexualité à 12 ans
Il co-écrit une pièce de théâtre The Blueboy in Black (le Garçon bleu en noir)
A 15 ans il se décide à écrire son premier roman passionné sur son homosexualité The Tower Window (la Fenêtre de la tour)
A 29 ans il a déjà dépensé 7 ans de sa vie et des milliers de dollars chez trois psychanalystes différents, il avait commencé une psychanalyse à l’âge de 15 ans, puis pendant 12 ans, sur une période d’une vingtaine d’années ; il a finalement trouvé un praticien, écrivain lui-même, qui l’a beaucoup aidé à écrire.
Devenu professeur de littérature comparée il se passionne pour de nombreux auteurs et autrices, et met en regard leurs approches de l’écriture et de la vie.
Son premier livre a été The Joy of Gay Sex co-écrit avec Charles Silverstein, un « acte important de dévoilement » pour lui, puis il a écrit States of Desire sur la variété de l’expérience gay et la diversité de la vie gay
Il écrira (avec la date des traductions françaises) Nocturnes pour le roi de Naples 1983, Un Jeune américain 1984, Le Héro effarouché 1986, La Tendresse sur la peau 1988, Oublier Elena 1989, Genet 1993, La Bibliothèque qui brûle 1997 (qui regroupe de nombreux textes).
Lors des émeutes de Stonewall en juin 1969 à Greenwich village, il est là, il y voit une manifestation dadaïste qu’une prise de la Bastille, il participe peu ou prou aux évènements, et jouera ensuite un rôle actif dans la libération gay dès ses origines ; il se souvient qu’un manifestant a crié « Pouvoir gay » ce qui le fit éclater de rire, il écrira en 1980 que « l’idée que les homosexuels puissent devenir militants à la manière des noirs semblait amusante pour deux raisons, d’abord parce que nous avions coutume de nous juger trop efféminés pour protester contre quoi que ce soit et ensuite parce que la plupart d’entre nous ne se considérait pas comme une minorité véritable… Nombre de gays suivaient une thérapie ou estimaient qu’ils le devraient, et l’idée d’une libération gay nous avait paru aussi absurde que celle de libération névrotique », il ajoute que si Rap Brown – successeur de Stockeley Carmichael en 1967 à la tête du Comité de coordination des étudiants non violents des Black Panthers – a proposé une coalition entre Noirs et gays, cette suggestion n’avait guère l’aval de son organisation ; il dira « nous avions des réunions sur le modèle de celles des femmes, qui étaient en fin de compte, me semble-t-il, des séances maoïstes, de prise de conscience… Nous étions nombreux à croire que nous étions foncièrement hétérosexuels en dehors de cette petite bizarrerie, cette habitude sexuelle que nous avions fortuitement contractée. Même l’idée d’une culture homosexuelle nous aurait semblé comique ou ridicule, et certainement horrifiante. Nous aurions voulu cantonner notre maladie à la plus petite partie possible de notre vie, à notre comportement sexuel, point final. »
Au début des années 1970 il répond à une annonce parue dans l’East Village Other qui cherche 500 jeunes modèles masculins sans que cela débouche sur quoi que ce soit.
En 1971 paraît le livre Maurice d’Edward Morgan Forster, Edmund White considère que ce n’est pas un ouvrage homosexuel mais une fantaisie masturbatoire, « Forster connait encore moins bien l’univers homosexuel que l’hétérosexuel et s’en remet à ses fantasmes ».
En 1977 il donne une conférence sur Les joies de la vie gay devant un groupe d’étudiants à Washington, il écrit des articles pour Christopher Street. C’est l’année où il commence à enseigner dans les universités de Yale, Columbia et John Hopkins.
Il se souvient qu’à Rome il n’y avait qu’un seul bar gay le Saint-James fréquenté par des tapins en veste de velours ajustées. A New York il fréquente le Zoo et le Zodiac, un gogo boy y fait un numéro avec une serviette blanche sur les hanches, il montera dans sa voiture et découvrira que c’est un garçon de Brooklyn qui parle de la drague furtive dans les rues et des rencontres anonymes dans les bains turcs.
White note qu’après Stonewall la vie gay new-yorkaise présente une qualité nouvelle. « Dans l’ensemble, nous sommes plus gentils avec nos amis. Découvrir qu’une célébrité est gay ne la rabaisse pas automatiquement à nos yeux ».
En 1979, il est marqué par la violente campagne anti homosexuelle d’Anita Bryant en Floride,
Le 8 janvier 1979, il écrit un article sur le « sadomasochisme » dans New Times, il distingue la double signification du mot, les actes criminels et brutaux de violence non sexuelle, et les jeux érotiques innocents.
En 1980 il a un entretien avec Truman Capote et le 13 mai 1988 il rendra compte de The Capote Reader. Il écrit que les textes de Capote sont aussi élégants et calculés que ceux de Prosper Mérimée, dont les premiers romans Les Domaines hantés et La Harpe d’herbe, se déroulent dans le Sud, des petites villes et des grandes prétentions, aux manières courtoises et aux préjugés sauvages. White voit dans les chiots, chatons et serpents qu’il découvre chez lui de parfaits emblèmes d’un homme qui célèbre à la fois l’amour familial dans A Christmas Memory et a écrit De sang-froid, la chronique la plus détaillée d’un assassinat des temps modernes.
Edmund White rencontre chez Capote Robert Mapplethorpe qui veut les photographier, Capote qui apprécie beaucoup ses photos, ne manifeste pas le moindre intérêt pour le beau Mapplethorpe, ni pour son ami qui l’assiste, Marcus Leatherdale qui ressemble à James Dean. Capote est embarrassé quand il doit faire la moindre allusion à l’homosexualité de ses héros, Collin le narrateur de La Harpe d’herbe amoureux de Maude a plutôt des goûts sexuels ambigus. Quand White l’interroge sur le portrait qu’il fait de Tennessee Williams lors de la sortie de son livre Musique pour caméléons dans lequel il le traite de loque alcoolique avec un gigolo engagé pour le distraire, Capote répond « Tennessee a été furieux ! … Nous avons eu tous deux des hauts et des bas. Nous nous connaissons depuis mille ans. Je crois que c’est un génie. C’est monstrueux les avanies qu’on lui a fait subir… L’Amérique en général manque totalement de respect pour les artistes » conclut Capote. White voit dans Petit déjeuner chez Tiffany de Capote la transcription réussie des histoire berlinoises d’Isherwood.
En février 1981 Edmund White décrit sa visite à William Burroughs, dans Soho News, il évoque Cités de la nuit écarlate son livre le plus ambitieux depuis Le Festin nu, « livre obsédé par les jeunes adolescents, beaux et impitoyables rouquins couvets de plaies érotiques, qui se pendent mutuellement jusqu’à l’éjaculation et dont les yeux s’illuminent quand ils jouissent et meurent ». Chantre des souvenirs anciens d’une adolescence disparue, Burroughs vit dans le vestiaire d’une ancienne YMCA.
White évoque le livre d’Andrew Holloran sur la jet-set gay Dancer from the Dance dans lequel « les allusions abondent sur les ‘tantes itinérantes’, ces hommes qui non seulement vivent chez eux dans un milieu de bars, de bains et de discothèques mais font inlassablement la tournée des centres gays, New York, Atlanta, Key West, La Nouvelle-Orléans, Los Angeles, San Francisco, Denver et retour ». White parle aussi du superbe roman d’Andrew Holloran Nights in Aruba.
En 1983, White écrit dans Vanity Fair sur la culture sexuelle.
Le 29 mars 1984, White écrit sur Nabokov, par-delà la parodie, « le romancier le plus passionné de ce XXè siècle, le grand prêtre de la sensualité et du désir, le mage qui n’ignore rien de ce qui est à la fois la plus solennelle et la plus insaisissables de nos joies douloureuses, le choc du plaisir érotique, cet emblème de la fugacité du bonheur sur terre », il apprécie le ton élégiaque, tendre et sensuel de Nabokov, « c’est le génie d’un endroit (ou d’une langue) que d’avoir perpétué, presque seul de notre siècle, une tradition de sensualité rendre »
White loue la capacité qu’a eu Marcel Proust de créer des personnages qui sont des parodies de lui-même, il prête « son dilettantisme à Swann, son homosexualité à Charlus, son amour de la famille au narrateur et sa haine de la famille à Mlle Vinteuil, son hypocondrie à la tante Léonie, son génie à Elstir et à Bergotte, son snobisme aux Guermantes, sa francité à Françoise ».
En 1985, Edmund White veut garder le contact avec James Jones à Paris dans l’Ile Saint Louis, il le rapproche d’Ernst Hemingway « contrairement à lui, Jones se souciait d’analyser les relations entre les hommes et les femmes », Jones assimilait pour lui « les grosses foutaises masculines » de Hemingway aux besoins qu’ont les gens de mythes dangereux mais consolants.
En mai 1986, White fait l’éloge de Christina Stead, la femme qui aimait la mémoire (1902-1983), autrice de 13 romans et de deux recueils de nouvelles, « une sorte de D.H. Lawrence féminin, enfance très difficile, famille étouffante, mais écrivaine avec facilité, romancière-née, elle a une langue délicieusement d’arrière-garde par son vocabulaire succulent, sa syntaxe imprévisible, ses tournures artisanales »
White se penche sur Cigarettes de Harry Mathews qui évoque irrésistiblement pour lui la prose de Jane Austin, ils décrivent à peine les personnages et les lieux, et alternent les scènes au style direct et les récits au discours indirect couvrant des périodes plus vastes.
En janvier 1987, il écrit dans Art Forum le texte Deuil et esthétique, évoque son ami peintre Kris Johnson mort il y a deux ans du sida et parcours les expressions artistiques les plus visibles du sida, films et dramatiques télévisées qui soulignent l’expérience humaine bouleversante qu’est le sida pour l’amant, l’infirmière, la famille, le patient, au cours des années 1983-1986, parmi lesquelles la pièce de Larry Kramer et 1985 The Normal Heart ; cette période dramatique liée au sida lui rappelle son vécu des années d’ « adolescence solitaire » pendant lesquelles il se sentait « tout drôle d’être pédé », « nous nous sentons de nouveau bizarres, méprisés, étrangers » ; « Avoir été opprimée dans les années cinquante, libérée dans les années soixante, exaltée dans les années soixante-dix, et anéantie dans les années quatre-vingt est un parcours bien rapide pour une culture » ; « Je me sens très seul avec la maladie. Mes amis sont en train de mourir. L’un d’eux m’a demandé de faire une prière pour nous tous à Venise, à Santa Maria della Salute »
White rencontre à Paris la romancier yougoslave Danilo Kis, un macho à l’américaine, beau mais bête, profondément cultivé.
En avril 1988, Jordan Elgrably s’entretient avec Edmund White pour Prais Review lors de la parution d’Un jeune américain, ils se connaissent bien, ils participent souvent à des débats littéraires à Paris ou au Village Voice à New York. White témoigne de son immense culture littéraire, il raconte sa passion des livres et des auteurs (Molière, Racine, Shakespeare, Crébillon fils, Vladimir Nabokov, Faulkner, Nadine Gordiner, Flaubert, Proust, Henry James, Emerson, Richard Ford, Raymond Carver, Hawthorne, Angelo Rinaldi, Flaubert, Barbara Pym, Joyce, Jane Austin, Jonathan Raban, Alan Hollinhurt, E.M. Forster, Kundera, William Gass, Paul Claudel, André Malraux, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Alejo Carpentier, Colette, Knut Hamsun, Robert Coover, Pynchon, William Gaddis, Robert Ferro, Cynthia Ozick, W.M. Spakman, James Merill, Chateaubriand, Stendhal, Edgar Poe, Oscar Wilde, Tolstoï, Dostoïevski, Synge, Nathalie Sarraute, Jouhandeau, Jean Genet, André Gide, Freud, Piaget, Tchekhov, Stanislavski, T.S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens, John Ashbery, Yukio Mishima, Thomas Mann, Christopher Isherwood, William Burroughs, John Rechy, Sade, Georges Bataille, etc.), il aime montrer les liens qu’il y a entre les uns et les autres (Cocteau et la Chartreuse de Parme, Radiguet et la Princesse de Clèves ; il raconte sa vie dans le monde gay à Greenwich Village et sa passion de l’écriture est ancienne « J’écrivais des livres gays bien avant la libération gay et avant qu’il n’y ai un public gay reconnu… il y avait une prodigieuse auto-répression chez les directeurs littéraires homosexuels, ils refusaient les livres gays parce que, s’ils avouaient les aimer, il leur aurait fallu les défendre dans des réunions éditoriales, au risque de laisser soupçonner leur homosexualité à leurs collègues » ; White analyse une différence entre les relations homosexuelles et hétérosexuelles, pour les premiers « quand la phase (amoureuse) s’achève leur amitié devient plus tendre et meilleure », pour les seconds « il leur est très difficile de passer de la fin d’une liaison à une amitié durable »
En 1989, White rédige un éloge funèbre de Robert Mapplethorpe (1946-1989), il avait travaillé avec lui lors des reportages sur Truman Capote et William Burroughs ; ses goûts sexuels le conduisait dans les quartiers les plus pauvres de New York, un jour il lui avait demandé de veiller sur son amant, un marin déserteur, campagnard du Sud terrifié par la grande ville ; Robert était un athlète aux épaules massives, toujours calme et silencieux, énigmatique, il passait pour un dandy parce qu’il semblait placer la beauté avant la bonté, il soignait son apparence et vivait dans un univers nocturne et très artificiel ; Bruce Chatwin et lui s’étaient liés d’une grande amitié, Bruce a écrit sur Robert des textes très brillants.
En 1991, Edmund White s’exprime dans le New York Times Magazine à l’occasion du mois du livre gay ; il raconte la naissance de la littérature gay, avec en 1978 Faggots de Larry Kramer er Dancer from the Dance de Andrew Holleran « qui tous deux illustraient la nouvelle culture gay engendrée par la prospérité de la libération et la tolérance de la société », en 1979 sept écrivains gay formaient le club informel baptisé la Plume violette (the Violet Quill), Felice Picano, Andrew Holleran, Robert Ferro, George Whitmore, Christopher Cox, Michael Grumley et Edmund White, avec des visites de Vito Russo qui avait réalisé The Celluloid Closet. White a quitté le groupe en 1983 pour s’installer à Paris, lorsqu’il est revenu à New York en 1990 le groupe avait disparu, quatre d’entre eux étaient morts, puis bientôt Vito Russo aussi, dans Ground Zero Holleran exprime « le sentiment des survivants de mener une vie posthume », étaient morts aussi des écrivains plus jeunes comme Tim Dlugos, Richard Umans, Gregory Kilovakos, le traducteur Mathew Ward et le romancier John Fox, ainsi que les deux amis les plus proches d’Edmund White, le critique littéraire David Kalstone et son éditeur Bill Whitehead, « Pertes définitives pour moi. Les témoins de ma vie, les gens qui avaient partagé références et humour n’étaient plus. Les livres qu’ils auraient pu écrire représentent une perte incalculable », il rapproche cela du fait que simultanément « la littérature gay est en pleine santé et plus florissante que jamais », le sida fait aussi que le phénomène de l’homosexualité est « un élément familier du paysage américain », même auprès de lecteurs hétéros, de la même façon que cela se passe désormais avec la littérature juive ou la littérature noire ; White a assisté à la conférence des écrivains Out/Write en compagnie de 1 800 lesbiennes et gays, cela lui rappelle que lors le première conférence littéraire gay européenne de Londres, aucun écrivain français de sexe masculin (et Geneviève Pastre seule représentait les lesbiennes) n’accepta d’y participer trouvant insultant le sobriquet « écrivain gay », les journalistes de Masques lui ont alors dit qu’il était le premier à accepter de se dire tel ; White note que le mouvement littéraire gay américain se développe grâce aux revues de qualité qui publient des nouvelles gays (Outlook, James White Review, Christopher Street, Tribe), souligne l’importance de Eve Kosovsky Sedgwick avec l’Epistemology of the Closet (sur Melville, Wilde, Nietzsche, James et Proust), John Boswell sur l’histoire gay du Moyen Age ou Luce Irigaray avec This Sex Which is No One, du grand colloque lesbien et gay récent d’Harvard, du Centre d’études lesbiennes et gays de Yale avec les cours de littérature de Brown (sur Virginia Woolf, Willa Cather, Djuna Barnes, Forster et Proust), ou encore les écrivains Armistead Maupin, David Leavitt, Michael Cunningham, Robert Glück, Allan Gurganus ou Dennis Cooper, il ne voit qu’une vingtaine de librairies prospères aux USA spécialisées dans la littérature gay et lesbienne, les autres ont bien des difficultés à conserver des titres gays.
En 1991, White rédige une introduction à la version anglaise de Un Captif amoureux ouvrage posthume de Jean Genet mort en 1986, Genet cultivait le silence et l’anonymat, il a été très éprouvé par la mort de son amant le funambule Abdallah en 1964 ; un Captif amoureux relate les années passées avec la Panthères noires aux USA jusqu’en 1972 et les soldats palestiniens en Jordanie et au Liban, il livre son admiration pour le courage, la beauté, la gaité, l’invention intellectuelle et verbale de ces jeunes hommes qui appartiennent à des peuples sans terre ; il évoque aussi la maison qu’il a fait construire au Maroc pour son ami marocain Mohammed El-Katrani ; dans ce livre s’exprime la tension entre le culte romantique de l’individu unique et la foi chrétienne en l’égalité spirituelle.
En 1991 encore il écrit le texte « Femmes hétéros, hommes gays »
En juin 1991, White écrit sur Juan Goytisolo qui lui rappelle les grands écrivains internationaux Borges, Calvino ou Cortazar. Espagnol né dans une famille franquiste de la haute bourgeoisie, il s’exila en France à l’époque de Franco en 1955, il vit entre Marrakech et Paris, vit avec Monique Lange ; enfant, son grand-père s’est livré sur lui à des jeux sexuels, le caressant et le masturbant, il se considèrera comme appartenant à une race de damnés ; par l’entremise de Monique il a rencontré Jean Genet, modèle d’intégrité artistique, de simplicité personnelle, d’activisme politique et de liberté sexuelle, jeune homme coincé Genet le surnomme l’hidalgo. En 1962, Goytisolo trouve la libération qu’il cherchait dans une rencontre de hasard avec un ouvrier arabe, Mohammed, lorsqu’il s’était senti attiré par la quartier arabe de Barbès, cette rencontre aura une influence décisive sur son œuvre avec la trilogie Pièces d’identité, il se passionne pour l’histoire de la présence arabe en Espagne ; comme Genet et Pasolini il est un Européen gay attiré par le tiers-monde au travers de ses goûts érotiques, et développe comme eux l’activisme politique et l’innovation artistique, grâce au pouvoir révolutionnaire et anarchique de la sexualité, le corps désirant faisant sauter les limites stériles des institutions sociales.
Le 12 novembre 1993, Edmund White s’exprime au Centre d’études lesbiennes et gays de l’université de l’université de New York sous le titre « Ce qui est personnel est politique : roman et critique homosexuels », il reconnait son silence presque total face au sida à l’exception des nouvelles The Dark Proof, et parle surtout de son travail et de ses livres Oublier Elena en 1973 qu’aucun critique n’avait vu comme homosexuel et que Nabokov avait couvert d’éloges, puis il passe en revue tous ses livres, il souligne enfin le rôle central que le roman homosexuel joue dans la formation de notre nouvelle culture
Le 4 novembre 1994, White écrit dans le London Review of Books l’article « Hervé Guibert : Sade en jeans », il voit en Hervé Guibert, mort en 1991, un héritier de Sade et de Bataille, inspiré par Francis Bacon, il mélange observation scientifique et scènes de sexe ; White l’a rencontré par l’intermédiaire de Michel Foucault lequel aimait les soirées entre hommes, de préférence des jeunes gens de talent, Jacques Almira, Gilles Barbedette, Mathieu Lindon ou Hervé Guibert, tous romanciers gays séduisants ; Guibert a 28 ans, avec un air sérieux halluciné, poli, lointain, distrait, puis silencieux, grave, incandescent lorsqu’il prenait Foucault à part, il était l’un des jeunes écrivains français les plus prometteurs ; il comprit rapidement que le sida n’était pas simplement une curiosité médicale ou un produit de l’hystérie américaine mais son destin et un sujet rassemblant sa haine de son corps, son goût du grotesque, le goût compulsif de choquer et sa folie de la mort, sujet qui lui donnerait aussi quelque chose de neuf, il trouve grisant cette proximité de la mort il écrira « depuis que j’ai 12 ans la mort est une marotte » puis « en 1990, j’ai 95 ans, alors que je suis né en 1955 » ; hanté par ses héros Sade, Artaud, Strindberg, Nietzsche, Thomas Bernhard et son vrai modèle Rimbaud il ne cesse d’écrire, entre crises de délire, amnésie et troubles moteurs ; il parlera de Foucault, sous le nom de Musil, qui de son côté lorsqu’il a entendu parler du sida pour la première fois, a éclaté de rire, si fort qu’il en tombe du canapé « un cancer qui toucherait exclusivement les homosexuels, non, ce serait trop beau pour être vrai, c’est à mourir de rire ! »
Le 9 mars 1995 il écrit le texte intitulé « Aujourd’hui l’artiste est un saint qui écrit sa propre vie », cite les écrivains importants du moment aux USA (Paul Monette, David Leavitt, Armistead Maupin), en Grande-Bretagne (Alan Hollinghurst, Paul Bailey, Adam Mars-Jones), en Italie (Tondelli, Aldo Busi) et en France (Violette Leduc, Dominique Fernandez, Tony Duvert, Renaud Camus, Hervé Guibert, Guy Hocquenghem, Giles Barbedette, René de Ceccatty), ainsi que le poète portugais Pessoa.