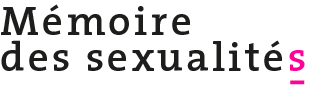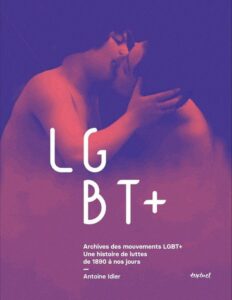 LGBT+ : archives des mouvements LGBT+ : une histoire de luttes de 1890 à nos jours, Antoine Idier
LGBT+ : archives des mouvements LGBT+ : une histoire de luttes de 1890 à nos jours, Antoine Idier
150 ans de luttes pour les droits LGBT à travers les archives.
À partir d’archives pour la plupart inédites, ce livre retrace sur la longue durée une histoire des luttes et mouvements LGBT en France.
Nourri d’une investigation documentaire de grande ampleur, l’ouvrage présente une riche iconographie distribuée selon des séquences chronologiques : affiches, couvertures de journaux ou revues, tracts, correspondance, photographies…
L’auteur a invité une vingtaine de grands témoins à commenter le document de leur choix. Cette pluralité des points de vue des contributeurs, chercheurs ou militants de différentes générations, permet d’incarner la diversité des mouvements rassemblés sous le nom LGBT.
Des persécutions jusqu’aux premiers mariages homosexuels en passant par les années sida, ce livre montre l’ampleur des combats menés, la violence des préjugés et des injustices comme le déni des partis politiques.
Différents courants de pensée se structurent au fil des décennies, les militants s’engagent dans des combats sociétaux et font preuve d’une détermination à la mesure des enjeux. Ils ouvrent la voie à une conception du vivre-ensemble qui substitue au conformisme une éthique d’ouverture sociale et culturelle.
Analyse de l’ouvrage par Mathias Quéré
« 1La sortie de l’ouvrage d’Antoine Idier intervient à un moment particulier dans le processus de préservation et de la communication des archives LGBTQI en France. Il convient en quelques mots d’en rappeler les enjeux. Il n’existe pas en France, contrairement à de nombreux pays occidentaux, de centre d’archives consacré spécifiquement aux questions LGBTQI. Les archives sont donc principalement des archives privées, préservées par celles et ceux qui ont fait ou accompagné cette histoire, et qui ont eu la rigueur et la perspicacité de les conserver. Pourtant, plusieurs initiatives ont, depuis le début des années 2000, cherché à voir le jour, portées par diverses générations de militant.es. Sans jamais aboutir à la création d’un centre d’archives. Si quelques groupes militants et des individus ont aujourd’hui déposé leurs archives auprès d’une institution publique, l’urgence d’une démarche de préservation – quelle qu’elle soit – est toujours d’une pressante actualité : toute une génération militante, celle des années 1960, 1970 et du début des années 1980, est en train de vieillir – pour ceux qui n’ont pas été décimés par le sida. N’ayant de manière générale pas d’enfants, lorsque l’un.e d’entre eux/elle décède, et que les neveux et nièces viennent revendre l’appartement de cette grande tante, tous ces cartons d’archives peuvent paraître bien encombrant et se retrouvent sur le trottoir. »